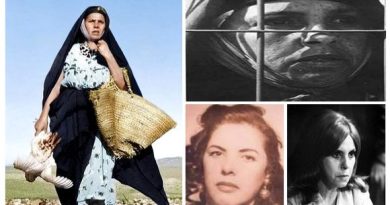La S’beiba de Djanet : Quand le désert danse avec l’histoire
Dans l’écrin doré du Tassili N’Ajjer, Djanet vibre au rythme ancestral de la S’beiba, cette fête millénaire qui transforme chaque année la perle du désert en théâtre vivant de la mémoire collective. Alors que le mois de Moharrem inaugure la nouvelle année hégirienne, la population locale se prépare à célébrer l’un des rituels les plus fascinants du patrimoine culturel algérien, une tradition qui mêle spiritualité, art martial et poésie dans un spectacle unique au monde. La S’beiba, ou « Kili T’sibiya » comme l’appellent les habitants, signifie littéralement « danse de l’épée » en tamasheq. Cette appellation révèle déjà la dimension spectaculaire de cette célébration qui trouve ses racines dans l’histoire sacrée du sauvetage du prophète Moussa, fuyant la poursuite du pharaon. Coïncidant avec la fête religieuse de l’Achoura, le dixième jour de Moharrem, ce rituel transcende le simple folklore pour devenir une véritable communion spirituelle et culturelle.
L’originalité de la S’beiba réside dans son caractère unificateur : elle réconcilie symboliquement les deux anciens quartiers de Djanet, El-Mizane et Azelouaz, dans une chorégraphie guerrière où les représentants des deux ksour s’affrontent dans un combat rituel hautement codifié. Cette confrontation, loin d’être belliqueuse, scelle au contraire un pacte de paix et de renouvellement communautaire, marquant le passage d’une année à l’autre dans une atmosphère de fraternité retrouvée.
La magie opère dès les « Timoulaouine », ces préparatifs minutieux qui précèdent la fête proprement dite. Les hommes des deux quartiers revêtent leurs plus beaux costumes traditionnels, les « Aghelay N Tikmessine », ces tenues d’apparat qui transforment chaque participant en ambassadeur d’une époque révolue. Les tambours résonnent dans l’air du désert, accompagnant les joutes poétiques où la « S’beiba » déploie toute sa richesse linguistique et prosodique, transmise oralement de génération en génération.
Cette année, la dimension académique de la fête a pris une importance particulière avec l’organisation d’une rencontre scientifique rassemblant chercheurs algériens et libyens autour de la préservation de la poésie S’beiba. Les spécialistes ont exploré les mécanismes de sauvegarde de ce patrimoine immatériel, soulignant l’urgence de créer des plateformes numériques pour archiver et transmettre ces textes séculaires aux générations futures. L’analyse des dimensions linguistiques, esthétiques et sociales de cette poésie révèle la complexité d’un art qui dépasse largement le cadre festif pour constituer un véritable manuel d’histoire et d’identité régionale.
Le commissaire du festival, Nacer Bekkar, insiste sur l’importance de ces initiatives académiques pour préserver un patrimoine menacé par l’oubli : « La S’beiba n’est pas seulement une fête, c’est une bibliothèque vivante qui raconte l’âme du Tassili N’Ajjer ». Les recommandations issues de cette rencontre scientifique pointent vers la nécessité d’intensifier les recherches universitaires et d’exploiter les nouvelles technologies pour documenter et diffuser ce trésor culturel.
L’apogée de la célébration se cristallise dans l' »Aghelay N Outay », cette scène finale où les guerriers des deux ksour s’affrontent dans un ballet martial d’une intensité saisissante. Cette confrontation symbolique, chorégraphiée avec une précision millénaire, se conclut par une réconciliation qui réaffirme l’unité de la communauté et son attachement indéfectible à ses racines. Au-delà du spectacle, c’est toute une philosophie de la coexistence et du respect mutuel qui s’exprime dans ces gestes codifiés depuis des siècles.
La S’beiba de Djanet démontre comment une tradition ancestrale peut survivre aux mutations du monde moderne en conservant sa force d’attraction et sa capacité à rassembler. Dans un monde où l’uniformisation culturelle menace les particularismes locaux, cette fête du désert offre un modèle de résistance créative, où la préservation du patrimoine s’accompagne d’une ouverture vers l’avenir. Elle rappelle que l’identité culturelle ne se nourrit pas de nostalgie stérile mais de la capacité à réinventer perpétuellement ses héritages dans le présent vivant.
Mohand S.