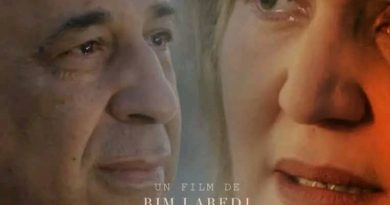28e SILA : L’IA et le patrimoine au cœur des débats
Le 28e Salon international du livre d’Alger propose jusqu’au 8 novembre un riche programme de rencontres et conférences sur la littérature, l’histoire, l’identité et les causes de libération. Dans ce sens, trois rencontres ont rythmé les débats lundi: l’impact de l’intelligence artificielle sur l’industrie du livre, la sauvegarde des manuscrits algériens dispersés en Afrique et les liens civilisationnels entre l’Algérie et la Mauritanie, invitée d’honneur de cette édition qui rassemble 1254 exposants issus de 49 pays.
L’impact de l’intelligence artificielle sur la création littéraire et l’industrie du livre a mobilisé universitaires et éditeurs lors d’une rencontre-débat qui a révélé un consensus autour de cette technologie désormais considérée comme incontournable. Face aux résistances initiales du secteur, les participants ont plaidé pour une adoption raisonnée de l’IA, capable de concilier innovation technologique et préservation de la créativité. L’universitaire Ibrahim Boudaoud a rappelé que malgré « la résistance des éditeurs face à l’adoption de l’IA », cette technologie s’impose comme « un levier fondamental pour le développement et l’amélioration de l’édition, ouvrant de nouveaux horizons à la créativité et à l’interaction avec le lecteur ». Le chercheur a toutefois reconnu la persistance d’inquiétudes légitimes, affirmant que « cette révolution numérique suscite encore des craintes d’ordre éthiques et légales chez les écrivains et éditeurs, concernant la protection de la propriété intellectuelle des œuvres générées par l’IA et son impact économique sur l’emploi ». Pour lui, « l’IA ne doit pas être rejetée, mais plutôt adoptée de manière appropriée pour revitaliser l’industrie du livre dans les pays arabes », à condition que les opportunités offertes constituent « un facteur d’équilibre entre le développement technologique et la préservation de la créativité et de l’innovation, garanti par la législation qui protège les droits des auteurs et des éditeurs ».
Ahmed Daï, enseignant en bibliothéconomie à l’université d’Alger, a souligné les avancées concrètes apportées par l’intelligence artificielle au domaine de l’édition et de la littérature, notamment à travers des algorithmes qui « facilitent la traduction contextuelle, la rédaction, la synthèse et la correction ». L’éditeur Mounir Benmhidi a abondé dans ce sens en évoquant l’accélération des processus de production et de commercialisation, estimant que ces transformations devraient entraîner la baisse des coûts liés aux transactions commerciales qui accompagnaient traditionnellement l’industrie du livre. L’éditrice égyptienne Fatima El Boudi a tempéré cet optimisme technologique en insistant sur la nécessité de « protéger les droits des professionnels » tout en reconnaissant que l’IA permet de réduire considérablement les coûts liés à l’édition et à la distribution.
Le patrimoine manuscrit algérien dispersé à travers le continent africain a constitué un autre axe majeur de réflexion lors d’une rencontre organisée à l’espace Assia-Djebbar. Les enseignants de l’université d’Adrar, Mebarek Djaafri et Abdeslem Kamoun, ont tracé les contours d’un héritage culturel qui témoigne des liens historiques profonds entre l’Algérie et l’Afrique subsaharienne. Mebarek Djaafri a expliqué que ces manuscrits, rédigés en arabe ou en tamazight, couvrent des domaines aussi variés que le droit islamique, la grammaire, la médecine, l’astronomie et le soufisme. Leur présence dans les bibliothèques africaines s’explique par la prospérité des centres de savoir qui ont fleuri à Tlemcen, Touat, dans le Mzab, à Tamanrasset, Tombouctou, Gao ou Kano, favorisant les échanges entre pays africains. Le conférencier a précisé que cette circulation des manuscrits s’est notamment opérée par « le déplacement des populations en route pour le pèlerinage, la traversée par les anciennes routes commerciales reliant Touat à Tombouctou et les liens entre les savants-commerçants algériens et ceux du Soudan occidental ». Il a souligné le caractère paradoxalement protecteur de cette dispersion, affirmant que le transfert des manuscrits algériens en Afrique avait été « salutaire » dans la mesure où cet important héritage fut « protégé et sauvegardé de la barbarie coloniale française, qui cherchait, dans sa politique infâme de déculturation, à détruire tout repère civilisationnel de l’Algérie ». Abdeslem Kamoun a insisté sur l’urgence d’un inventaire systématique, estimant que « ces manuscrits algériens ont grand besoin d’être inventoriés, numérisés, catalogués et classés, afin de pouvoir établir leur paternité et restituer les contenus de cet héritage ancestral intarissable ». Il a appelé à multiplier les coopérations bilatérales avec les pays africains détenteurs de ces manuscrits, en s’appuyant sur la convention de La Haye de 1954 et les dispositions de l’UNESCO qui considèrent les manuscrits comme un bien culturel à protéger.
Des liens entre l’Algérie et la Mauritanie
Les liens historiques entre l’Algérie et la Mauritanie, invitée d’honneur de cette 28e édition, ont également fait l’objet d’une conférence-débat riche en éclairages. L’universitaire mauritanien Mohamed Yahya Babah, de la Faculté des sciences islamiques d’Aïoun, a mis en exergue « les fondements doctrinaux communs ancrés entre l’Algérie et la Mauritanie à travers des siècles d’interaction civilisationnelle fructueuse, grâce à la mobilisation de l’acte religieux des oulémas et des imams qui ont contribué à la diffusion de la culture islamique ». Le poète et chercheur sahraoui Hamdi Uld Allal Uld Daf a évoqué le rôle de la culture comme arme de résistance, considérant que « les éléments culturels matériels et immatériels, dont la langue, l’habit traditionnel, le théâtre, la poésie, le chant, la danse et autres, constituent une arme douce pour faire face à toute colonisation ». Selon lui, « la réussite de la résistance commence par le degré de conscience du peuple quant à l’importance de préserver ses valeurs, son authenticité, sa culture et ses symboles ». Abdelmadjid Djaa, chercheur à l’université de Tindouf, a pour sa part analysé la symbolique culturelle commune dans l’espace hassani, soulignant l’existence « d’une dimension historique et humaine profonde qui a interagi dans leurs deux espaces, à travers des systèmes culturels multiples faits d’héritages et de symboles, ayant engendré un ensemble riche de significations reflétant l’unité du parcours civilisationnel des deux pays ». Ces débats témoignent de la richesse des échanges qui animent cette édition du SILA, plaçant l’innovation technologique et la préservation du patrimoine au cœur des préoccupations du monde du livre.
Mohand Seghir