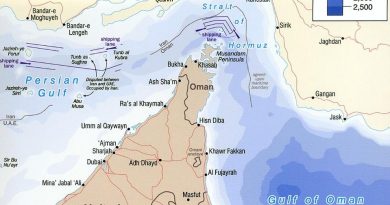Le climat contre le capitalisme ?
Par Jean Pisani-Ferry
Le dernier rapport du GIEC ne laisse aucun doute : le réchauffement climatique va se poursuivre au moins jusqu’en 2050, même si les émissions de gaz à effet de serre sont drastiquement réduites dans les décennies à venir.
Si le rythme de ces réductions est trop lent, canicules, sécheresses, précipitations violentes et inondations, à l’image de celles de cet été, seront plus fréquentes. On ne peut exclure des conséquences plus catastrophiques encore, comme une altération soudaine et irréversible du Gulf Stream et des courants océaniques.
Heureusement, l’opinion est de plus en plus consciente du problème. Une récente enquête des Nations unies indique que près des deux tiers des gens à travers cinquante pays considèrent le changement climatique comme une urgence. La question est donc désormais de savoir ce que doit impliquer l’action contre le réchauffement atmosphérique. Comment affectera-t-elle les revenus, les emplois et les conditions de vie ? La plupart des citoyens n’en ont tout simplement aucune idée, car on leur présente deux images très différentes de l’avenir.
D’un côté, les techno-optimistes sont convaincus que les nouvelles innovations vertes peuvent contribuer à résoudre le problème. Leur vision de l’avenir est simple : nous conduirons des voitures électriques au lieu de voitures à essence, nous voyagerons en train à grande vitesse au lieu de prendre l’avion et nous habiterons des maisons neutres en carbone. Les riches devront peut-être renoncer à partir en vacances sur d’autres continents, mais, dans l’ensemble, le mode de vie de tous les autres sera préservé.
Ceux qui doutent des bienfaits de la croissance, quant à eux, décrivent la transition vers la neutralité carbone comme un changement fondamental qui devra mettre fin à des décennies d’expansion fondée sur la consommation. Nous entrerons dans une nouvelle ère de « post-croissance », voire de « décroissance ». La qualité se substituera à la quantité, et l’interaction sociale à la consommation matérielle.
Les deux camps partagent l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais alors que les techno-optimistes font confiance au capitalisme vert pour conduire la transformation de l’économie, les sceptiques suggèrent que l’addiction à la croissance est destructrice, et que l’on ne peut en guérir qu’en mettant un frein au gaspillage privé. La lutte contre le changement climatique, selon eux, est une lutte contre le capitalisme lui-même.
Les économistes ont tendance à se ranger du côté des techno-optimistes. En 2009, Daron Acemoglu du MIT, Philippe Aghion du Collège de France et leurs co-auteurs ont observé que le progrès technique avait été massivement biaisé en faveur des technologies brunes (à forte intensité en carbone). Ils ont fait remarquer que les subventions publiques, les réglementations et la tarification du carbone orienteraient l’innovation vers des technologies plus propres, rendant la croissance verte de plus en plus efficace. Ces prédictions ont été confirmées par l’effondrement du coût des énergies renouvelables. Adair Turner, le président de la Commission sur les transitions énergétiques, note que pour de nombreux pays en développement, l’énergie verte devient rapidement moins chère que l’énergie fossile. Il en va de même pour les batteries électriques.
La raison en est que le capitalisme a amorcé un virage vert. Un nombre croissant d’entreprises investissent pour s’inscrire dans la construction d’un avenir plus propre. Tesla est aujourd’hui quatorze fois plus valorisée que General Motors, bien qu’elle ait vendu quatorze fois moins de voitures en 2020. Pourtant, le capitalisme brun persiste et lutte pour sa survie. Comme lorsque les intérêts agraires et manufacturiers s’affrontaient au XIXe siècle, la bataille décisive d’aujourd’hui ne se situe pas entre les activistes climatiques et le capitalisme, mais plutôt entre deux courants, sans doute deux âges du capitalisme lui-même.
C’est une bonne nouvelle. Mais deux mises en garde s’imposent. Premièrement, même si la technologie vient à la rescousse de la société de consommation, les modes de vie devront tout de même changer. Nombreux sont les logements périurbains à forte consommation d’énergie qui échoueront à passer le test de la neutralité carbone et risquent de se transformer en actifs échoués. Ce sera un désastre pour les ménages dont le principal actif est la valeur nette actuelle de leur maison. De même, la transformation profonde des régimes alimentaires fortement carnés perturbera d’anciennes traditions agricoles et alimentaires.
Les sceptiques de la croissance n’ont donc pas tort lorsqu’ils affirment que la technologie n’est pas une solution miracle. S’il est absurde de penser que la décroissance résoudra le problème climatique, il est parfaitement fondé, psychologiquement, d’avertir les gens que des changements de comportement seront nécessaires.
La deuxième mise en garde est que, même si les technologies vertes se révèlent moins coûteuses que les technologies traditionnelles, les coûts de transition seront, eux, substantiels. Après avoir tergiversé pendant si longtemps, nous sommes maintenant confrontés à un changement soudain et brutal. En termes simples, une part importante du stock de capital existant – bâtiments, machines, véhicules – devra être mise au rebut et remplacée avant d’atteindre la fin de sa vie économique. Que cette élimination soit déclenchée par la tarification du carbone ou par des réglementations plus strictes en matière d’émissions n’a aucune importance. Dans tous les cas, des investissements plus importants seront nécessaires pour maintenir le même niveau de production.
Les économistes qualifient de « choc d’offre négatif » l’obsolescence soudaine du stock de capital, car son principal effet économique est de réduire la production potentielle (au moins temporairement). Cette expression a été inventée dans les années 1970 pour donner un sens à la hausse soudaine des prix du pétrole. Un calcul simple suggère que le choc qui nous attend au cours de la prochaine décennie sera à peu près du même ordre de grandeur.
La combinaison d’une réduction de la production potentielle et d’une augmentation des investissements – de l’ordre de 2 % du PIB, selon plusieurs estimations – implique que le bien-être des consommateurs en subira les effets. Plus précisément, il sera diminué à court terme et amélioré à long terme, comme lorsqu’un pays entreprend un réarmement militaire pour préserver sa sécurité. Par ailleurs, des emplois seront perdus dans les secteurs traditionnels à forte intensité en carbone, mais d’autres emplois seront créés dans les industries neutres en carbone. Là encore, cela impliquera des coûts de transition importants : les ouvriers des fonderies ne seront pas instantanément transformés en experts en isolation des bâtiments.
Les dirigeants politiques devraient être honnêtes sur ce qui arrive. Le président Biden louvoie lorsqu’il parle d’une « opportunité de créer des millions d’emplois syndiqués bien rémunérés pour la classe moyenne », tout comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lorsqu’elle suggère que le Green Deal européen est la « nouvelle stratégie de croissance » de l’Europe. Toutes deux ont raison de parler d’un avenir radieux, mais ont tort de négliger le fait que certains emplois seront détruits et la prospérité diminuée en cours de route.
Les citoyens sont conscients de l’urgence de l’action climatique, mais ils restent incertains quant à ses implications. Ce dont ils ont besoin, c’est de clarté, et non de promesses en l’air. La meilleure façon de convaincre les gens d’adhérer aux efforts de décarbonation n’est pas de minimiser les défis à venir, mais de les indentifier avec précision et d’expliquer comment ils seront relevés.
Copyright: Project Syndicate, 2021.
www.project-syndicate.org

Jean Pisani-Ferry, senior fellow au think tank Bruegel basé à Bruxelles et senior non-resident fellow au Peterson Institute for International Economics, est titulaire de la chaire Tommaso Padoa-Schioppa à l’Institut universitaire européen.