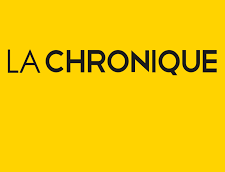Quelle politique des transports pour l’Algérie ?
Dr Abderrahmane Mebtoul
Professeur des Universités, expert-comptable diplômé de l’institut supérieur de gestion de Lille (1974) – directeur général des études économiques, haut magistrat et premier conseiller à la Cour des comptes (1980/1983, expert international et président de l’Association Nationale de Développement de l’Économie de Marché ADEM de 1992 à 2016.
Toute politique des transports passe nécessairement par une coordination interministérielle et des actions complémentaires dans d’autres domaines, comme la politique budgétaire, la politique énergétique et une nouvelle politique d’aménagement du territoire afin de favoriser le développement dans le cadre d’un espace équilibré et solidaire.
L’accident de bus d’Oued El Harrach qui a fait plusieurs morts et blessés incite à la réflexion interpellent le gouvernement sur la leçon à tirer notamment sur une nouvelle politique des transports liée à la politique des infrastructures et qui a un impact sur le développement et l’attractivité des territoires. Cette réflexion doit englober les différents segments du transport en Algérie.
1.- Le transport terrestre
Pour l’Algérie, selon l’ONS données reprises par l’APS en 2023, le parc automobile national y compris bus et camions comptait plus de 6,3 millions de véhicules tous types confondus, ce chiffre devant dépasser les 7 millions d’ici fin 2025, la demande annuelle en véhicules neufs étant estimée entre 600.000 et 700.000 unités. La structure est la suivante -Véhicules de moins de 5 ans : 19,32 % -Véhicules âgés de 5 à 9 ans : 22,08 % -Véhicules âgés de 10 à 14 ans : 17,22 % -Véhicules âgés de 15 à 19 ans : 22,08 % -Véhicules âgés de 20 ans : 19,3% . Ainsi, il ressort de ces données que 80 % des véhicules en circulation en Algérie sont vieilles de plus de 5 ans ; et près de deux tiers d’entre elles (58 %) ont plus de 10 ans d’âge. En outre, seuls 1/5 des véhicules ont moins de 5 ans, et 1/5 ont plus de 20 ans. Il s’agit là d’un effet palpable de la stagnation du marché lors des cinq dernières années. En ce qui concerne les réseaux de transport terrestre, force est de constater, souvent, le coût exorbitant du kilomètre d’une route en Algérie en référence aux normes internationales. En plus certaines administrations aussitôt les travaux d’une route terminés, outre le mauvais suivi , payent l’intégralité alors qu’il y a lieu de retenir 10 à15% comme garantie , expliquant les travaux mal faits qui nécessitent après une année ou deux ans de refaire les travaux sur les mêmes routes. Selon le Ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, dans une déclaration en date du 29 janvier 2024, avec la superficie estimée à 2 381 774 km², le réseau routier algérien a atteint une longueur de 141 500 km dont 8 900 km d’autoroutes et voies express. L’Algérie devrait être reliée à la Mauritanie grâce à un nouveau projet de réalisation d’une route reliant Tindouf en Algérie à Zouerate en Mauritanie, sur une longueur de 775 km. L’Algérie doit être aussi reliée au Mali, au Niger et au Nigeria à travers la route transsaharienne dont j’ai été officier d’administration entre 1971/1972 pour l’axe Ghardaïa /El Goléa/ In Salah.. Que ce soit pour les voyageurs ou pour les marchandises, la route accueille pas moins de 85% du transport. La structure de l’activité de transport nécessite également une réflexion. En 1988, elle était dominée par le public avec 90% d’entreprises étatiques et 10% de privés. Actuellement, c’est le contraire mais avec une atomisation influant sur la rentabilité globale comme en témoigne les faillites et le non remboursement de crédits de transporteurs individuels dans le cadre de l’ ex-ANSEJ. Le développement des transports informels est une réponse aux dysfonctionnements du système de transport public. Aujourd’hui, le transport par taxi clandestin est une activité tout à fait banalisée dans la plupart des villes algériennes. Leurs stations, improvisées, sont partout dans les différents quartiers des villes. Cette activité s’est développée ces dernières années. La crise économique y est pour beaucoup, certes, mais il y a, toutefois, lieu de rajouter d’autres considérations. La possession du capital (la voiture) ne constitue pas véritablement en soi une barrière à l’entrée du marché, les clandestins offrant un transport à la demande, meilleur marché, de jour comme de nuit.
2.- Le transport ferroviaire
Le réseau ferroviaire algérien s’étend actuellement sur 4 500 km, dont plus de 4 000 km en exploitation. Des projets de développement sont en cours pour augmenter cette longueur à 6 300 km à court terme et potentiellement à 15000 km d’ici 2030. Un programme d’investissement de 378 milliards de dinars a notamment été dévoilé en 2024, comprenant la modernisation des gares, des parcs de trains, l’installation de caméras de surveillance sur certaines lignes, le déploiement de distributeurs automatiques de billets . Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base a annoncé, le 08 février 2025 le lancement des travaux de réalisation de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset long de 2406 km, destiné à relier la capitale au grand sud, jusqu’à In Guezzam … début des travaux courant 2025 sans préciser le coût mais certainement plusieurs milliards de dollars. Sans oublier la ligne de Béchar à Gara Djebilet qui s’étend sur environ 950 km en plein Sahara, l’ANESRIF s’étant engagé à achever l’ensemble de la ligne avant la date contractuelle de mars 2026 destinée au fer mais également au transport des voyageurs. La SNTF devrait procéder également au doublement et à l’électrification de certaines voies.
3.-Le transport maritime
Concernant le transport maritime, il est le mode de transport le plus utilisé dans le commerce international (75% du commerce mondial en volume transitent par voie maritime) et plus de 97% des marchandises destinées à l’Algérie passent par les compagnies de transport étrangères. Actuellement, le pavillon algérien ne couvre que 11% des échanges commerciaux. La dépendance de l’Algérie à l’égard des armateurs étrangers paraît évidente, rendant urgent l’amendement du Code maritime, afin d’ouvrir cette activité à des opérateurs privés très intéressés par le secteur maritime. Le problème principal qui se pose, actuellement, est que les ports algériens qui ne répondent pas souvent aux normes internationales représentent le domaine public mais agissent, en même temps, comme entités commerciales. La gestion du secteur du transport maritime connaît certaines lacunes qui se traduisent par des coûts logistiques importants. Selon un rapport de la Banque mondiale, le coût moyen d’un conteneur de 20 pieds à l’importation est de 858 dollars en Tunisie, de 950 dollars au Maroc, alors qu’en Algérie il s’élève à 1.318 dollars. A l’exportation, le même conteneur coûte en moyenne 733 dollars en Tunisie et pas moins de 1.248 dollars en Algérie, soit un surcoût moyen annuel par rapport aux pays voisins de 400 millions de dollars. Concernant les surestaries, un séjour en rade d’un navire coûte entre 8.000 et 12.000 dollars par jour. Ces surcoûts entravent tout effort de compétitivité des entreprises nationales, notamment celles désirant un développement à l’exportation, et épongent les trésoreries des entreprises importatrices qui paient beaucoup plus cher le transport de leur marchandise. En plus des ports existants qui nécessitent un important investissement pour leur mise à niveau, l’Algérie avait décidé d’investir dans la réalisation d’un grand port commercial. Le port d’El Hamdania, d’un coût initial prévu entre 5 et 6 milliards de dollars, devrait disposer, selon le projet, de 23 quais d’une capacité annuelle de traitement de 6,5 millions de conteneurs et de 25,7 millions tonnes de marchandises, avec un trafic global en vitesse de croisière de 40 millions de tonne en plus du transbordement du trafic international. La durée prévisionnelle des travaux ayant été ramenée de 10 à sept ans, ce port devait être relié avec l’axe routier de l’unité africaine afin de faciliter la route de la Soie initiée par la Chine, projet auquel l’Algérie a adhéré. Or en rappelant que le groupe émirati DP World, est coactionnaire des ports de Djendjen et Alger, selon les dernières informations du mois de juin 2025, il serait abandonné par la Chine , avec la délocalisation du lieu , Projeté initialement à El Hamdania, dans la commune de Cherchell sur la côte de la wilaya de Tipasa, le méga-port en eau profonde devrait être réalisé sur la côte de la wilaya de Boumerdès selon le PDG du groupe public des services portuaires Serport le 9 juin 2025. L’Algérie, étant pour l’instant en pourparlers pas de contrat définitif avec CMA CGM pour un investissement de plusieurs milliards de dollars dans le développement dans plusieurs ports algériens, mais sans mentionner la part du financement l’opérateur français CMA CGM et la part de l’Algérie, cet opérateur une grande multinationale étant , déjà présent dans neuf ports algériens, dont Alger, Annaba, Béjaïa, Skikda et Ghazaouet, ambitionnant d’avoir la concession du port d’Oran avec une implication directe dans la gestion logistique s’agissant notamment d’une ligne maritime entre Marseille et Oran, et la construction d’infrastructures portuaires modernes, des terminaux à conteneurs à travers l’ensemble du territoire national.
4.- Le transport aérien
La compagnie aérienne nationale « Air Algérie » disposait entre 2022/2023 de43 agences dans 26 pays bien qu’il ait été procédé entre 2020-2021 au rappel de 50 expatriés et la fermeture de 9 agences , a transporté, sans compter d’autres compagnies étrangères présentes dont Air France, près de 8 millions de passagers en 2024, soit une hausse de 10% par rapport à l’année 2023. Ce résultat a été atteint à travers 79 100 vols, avec en moyenne 200 à 250 vols par jour. Air Algérie prévoit d’élargir son réseau international, qui dessert actuellement 44 aéroports internationaux, avec l’ouverture de nouvelles lignes vers Abuja (Nigeria), Amsterdam(Pays-Bas) et deux nouvelles connexions vers l’aéroport de Stansted à Londres (Royaume-Uni).. Le PDG d’Air Algérie a dévoilé en août 2024 un effectif de 8315 employés contre 10.000 vers les années 2020, mais révèle malgré cette baisse que le surplus d’effectifs était estimé à 3.000 employés mal répartis par les filiales et les services. Bien que bénéficiant d’un prix du carburant subventionné, pour faire face aux pertes enregistrées, Air Algérie avait sollicité un prêt gouvernemental, selon le conseil d’administration du 7 mai 2022, afin de faire face au déficit budgétaire estimé à 120 milliards de dinars, dont une partie est destinée à couvrir les dépenses de l’entreprise et les salaires des travailleurs, une partie à rembourser les dettes de l’entreprise. Ainsi, dans le cadre du Projet de loi de finances (PLF) pour l’année 2024, le ministère des Transports avait prévu une aide substantielle pour Air Algérie s’élevant à 10 milliards de dinars algériens, montant significatif qui intervient à un moment où Air Algérie en 2024 annonce un excédent financier après sept années de déficit. Par ailleurs le développement aérien est tributaire de l’achat de nouveaux appareils ou en location le ministère des transport ayant annoncé le 06 janvier 2025 l’acquisition de 16 nouveaux avions. Les appareils acquis, de types Airbus et Boeing, arriveront successivement et Air Algérie a affrété 8 autres appareils pour renforcer sa flotte et répondre à la demande exprimée ainsi que des d’investissements pour de nouveaux aéroports et l’extension de ceux existants devant répondre au nombre croissant de passagers. Dans ce cadre , il a été procédé au transfert des moyens matériels et humains de Tassili Airlines vers la nouvelle filiale, Domestic Airlines, en vertu de l’accord signé entre la société holding Sonatrach activités externes et de soutien (SAES) et la compagnie Air Algérie.
5- La politique des transport doit s’insérer dans le cadre d’une planification stratégique
Chaque mode de transport a des incidences sur la nature de l’énergie utilisée avec des impacts sur l’environnement. Dans ce cadre, une coordination entre notamment le Ministère de l’Energie et les autres secteurs énergivores à l’image des Transports et de l’Habitat devient urgente. Dans le secteur des transports, la consommation du gasoil, du fait des prix bas de ce carburant, a explosé ces dernières années. La maîtrise de la consommation de carburants, nécessite, au-delà des options suggérées concernant les modes de transport dont le transport en commun qui doit être modernisé pour éviter les drames des accidents, une politique des prix appropriée, en direction des autres usagers de la route. Car, toute politique des prix, pour s’inscrire dans la durée, doit permettre de couvrir l’ensemble des coûts directs et indirects, qui doivent être internalisés dans le prix des carburants sous forme de taxes, dont les recettes iront couvrir les dépenses d’infrastructures routières. Aussi une nouvelle politique s’impose par l’encouragement à l’utilisation de carburants alternatifs, comme les GPLc, et les énergies renouvelables. Est posé également le problème de la modernisation des infrastructures , cause également de nombreux accidents, car la politique des transports est intimement liée à la politique des travaux publics et il serait souhaitable qu’un seul ministère serve de régulation évitant les erreurs du passé où le constat est le suivant étant entendu que les enjeux institutionnels et de gouvernance contribuent largement à limiter la réussite des projets.: de nombreuses décisions de projets ne sont pas fondées sur des analyses socio-économiques. Ni les ministères d’exécution, ni le ministère des Finances n’ont, suffisamment, de capacités techniques pour superviser la qualité des études nécessaires à la programmation de ces investissements, se bornant au contrôle financier effectué par le ministère des Finances, le suivi technique (ou physique) exercé par les entités d’exécution étant inconnu ou au mieux insuffisant. Les résultats des projets et programmes ne font pas l’objet d’un suivi régulier. Il n’existe aucune évaluation, à posteriori, permettant de comparer ce qui était prévu avec ce qui a été réalisé et encore moins de comparer le coût-avantage ou l’efficacité avec la situation réelle. Or, les objectifs de développement face à la baisse des ressources en devises, de l’accroissement de la dette publique brute et des tensions budgétaires à venir sont de : (a) établir un cadre politique et institutionnel qui facilitera la participation privée dans l’infrastructure (PPI) ; (b) démontrer la viabilité de l’intégration des concessions dans les transports, à l’aide du lancement réussi du dispositifs BOT (Build-Operate-Transfer). De ce point de vue, le transport routier possède l’avantage de pouvoir autofinancer ses infrastructures par les péages ou les recettes fiscales induites. A l’inverse, les infrastructures ferroviaires ou portuaires nécessitent un apport extérieur massif en contributions publiques. Les enjeux futurs en matière de transport sont les suivants: réduire les circuits de distribution entre production et consommation; responsabiliser en faisant payer chaque mode de transport son juste prix, en y intégrant les coûts externes qu’il induit dont le principe «pollueur/payeur», au travers l’instauration d’une «pollutaxe» pour protéger les espaces naturels qu’ils traversent
En conclusion, toute politique des transports, poumon de la circulation des biens et personnes et d’une manière générale des infrastructures , pour son efficacité passe nécessairement par une coordination interministérielle et des actions complémentaires dans d’autres domaines, comme la politique budgétaire, la politique énergétique , et une nouvelle politique d’aménagement du territoire afin de favoriser le développement dans le cadre d’un espace équilibré et solidaire.
ademmebtoul@gmail.com