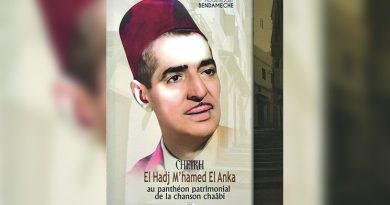L’Afrique est sous représentée dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : Remédier à une autre injustice
Douze nouveaux sites algériens candidats au classement sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, des statistiques qui révèlent un « préjudice » historique envers les patrimoines africain et arabe.
L’Algérie accueille cette semaine un workshop international réunissant des experts de plus de quinze pays africains et arabes, dans l’objectif affiché de corriger les déséquilibres criants de la liste du patrimoine mondial UNESCO. Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a inauguré lundi cet atelier international de formation consacré à « l’évaluation préliminaire des propositions de dossiers d’inscription sur la liste du patrimoine mondial des régions africaine et arabe ». Cette initiative, organisée en partenariat avec le Fonds du patrimoine mondial africain et avec le soutien du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, intervient en marge de la foire du commerce intra-africain à Alger, symbolisant cette volonté de convergence continentale. Les chiffres présentés par le ministre sont éloquents et justifient cette mobilisation urgente. L’Afrique ne compte que 122 sites classés, soit 8,97% du patrimoine mondial réparti sur 38 pays, tandis que les nations arabes n’en totalisent que 97 dans 18 pays, représentant 7,77% de la liste globale. Cette sous-représentation flagrante contraste avec la richesse patrimoniale de ces régions, héritières de civilisations millénaires.
« Cette organisation constitue une étape importante pour élaborer une nouvelle stratégie de soutien à la présence du patrimoine arabe et africain sur la liste du patrimoine mondial et formuler une vision commune de son avenir qui contribue à renforcer la sécurité culturelle, préserver la mémoire et investir dans les industries créatives comme levier de développement durable », a déclaré Zouhir Ballalou lors de son discours inaugural. Le ministre a présenté cet atelier comme « un prolongement naturel du rôle historique de l’Algérie en tant que terre de civilisations et de diversité culturelle ancestrale et station centrale dans le parcours de coopération arabo-africaine ». L’Algérie donne l’exemple avec une démarche volontariste. Le pays a mis à jour sa liste indicative en juin et septembre 2025 pour inclure douze nouveaux sites candidats au classement, dans une démarche stratégique visant à augmenter le nombre de ses sites inscrits et renforcer sa position culturelle mondiale. Parmi ces candidatures figurent le parc national de Djurdjura, celui d’El Kala, les sites d’Ighamaouen, le patrimoine archéologique de Tébessa, les palais de l’Atlas saharien algérien et les mausolées royaux des périodes antiques.
Cette dynamique s’inscrit, selon Ballalou, « en cohérence avec la vision éclairée du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui ne cesse de souligner l’importance de la culture comme levier fondamental dans le processus de construction de la nouvelle Algérie et de préservation de la mémoire nationale et de valorisation du patrimoine dans ses dimensions développementales avec l’ouverture sur la transformation numérique et l’innovation ». Le directeur général du Fonds africain du patrimoine mondial, Albino Jopela, a salué « cette initiative qualitative et les efforts de l’Algérie pour renforcer la protection et la préservation du patrimoine africain et arabe et son soutien au travail des experts dans le domaine pour élaborer une stratégie unifiée de préparation de nouveaux dossiers complets concernant le classement de sites culturels, naturels et mixtes pour élargir la présence de l’Afrique et des pays arabes dans la liste du patrimoine mondial ».
L’atelier rassemble des représentants du Conseil international des monuments et sites, de l’Union internationale pour la conservation de la nature et du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, aux côtés d’experts internationaux et de cadres du ministère de la Culture et des Arts. La coordinatrice de l’atelier, Rim Kelouaze, a détaillé les objectifs et résultats attendus de ces quatre journées de travail, rappelant l’atelier préparatoire « de haut niveau » organisé en juillet dernier. Les participants procéderont à la présentation, discussion et évaluation de dossiers proposés concernant des sites culturels et naturels de quinze pays, incluant la Tunisie, le Burundi, le Cameroun, le Gabon et la Guinée.
Cette initiative révèle une ambition plus large : transformer la culture en véritable levier géopolitique et économique. En proposant de « renforcer la sécurité culturelle » et d’investir dans les « industries créatives », l’Algérie dessine les contours d’une diplomatie culturelle africaine et arabe renouvelée. L’enjeu dépasse le simple prestige du classement UNESCO pour toucher aux questions d’identité, de développement touristique et de rayonnement international. Dans un contexte où l’Afrique et le monde arabe cherchent à s’affranchir des héritages coloniaux, la valorisation du patrimoine devient un enjeu de souveraineté culturelle et de construction d’un narratif alternatif aux récits occidentaux dominants.
Les travaux se poursuivront jusqu’au 11 septembre, avec l’objectif concret d’identifier les dossiers les plus prometteurs et d’harmoniser les méthodologies de candidature.
Mohand Seghir