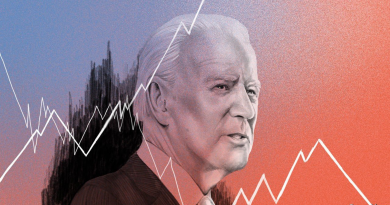Face au stress hydrique : L’Algérie s’impose comme un acteur majeur du dessalement

Par Mohamed Rachid Cheriti
Ingénieur spécialisé dans le domaine énergétique et le développement durable.
Confrontée au stress hydrique, contrainte climatique et à l’impératif d’une transition énergétique mondiale, l’Algérie orchestre une transformation radicale de sa politique des ressources hydriques.
Le pays, qui dispose d’un atout majeur avec son littoral méditerranéen de 1 200 km et d’un ensoleillement exceptionnel, a lancé une stratégie offensive articulée autour de deux piliers : le dessalement massif de l’eau de mer et le développement des énergies renouvelables et l’hydrogène vert. Cette double ambition, si elle se concrétisait, pourrait non seulement résoudre la crise de l’eau et d’énergie nationale mais aussi positionner le pays comme un acteur de premier plan sur la scène régionale.
Au-delà du changement climatique, la crise de l’eau est étroitement liée à la perte de biodiversité et à la désertification. Deux problèmes systémiques et mondiaux, les sécheresses et les inondations exacerbent l’érosion et la dégradation des sols, ce qui peut créer des cercles vicieux : des sols de moins en moins fertiles, incapables de supporter la végétation ou d’absorber les précipitations, une perte accrue d’eau douce et des terres défrichées pour cultiver, ce qui nuit aux communautés et à toute vie.
La quantité d’eau douce disponible a considérablement diminué en raison de la croissance démographique rapide, de l’industrialisation et des sécheresses extrêmes récurrentes. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), un cinquième de la population mondiale vit dans des pays où l’eau douce est rare, cette rareté est devenue un problème mondial urgent. Seulement 3 % de l’eau douce représente la totalité des ressources en eau de la planète, l’eau salée constituant les 97 % restants. Le World Resources Institute a mis au point une carte montrant les pays qui souffriront le plus du manque d’eau d’ici 2040, soit dans uniquement 15 ans. En se basant sur les projections climatiques, mais aussi sur l’augmentation envisagée de la population, le niveau de développement, l’urbanisation, ainsi que l’élévation du niveau de la mer qui va rendre insalubres certaines ressources, l’Institut a placé en risque extrêmement élevé de pénurie d’eau 17 pays, parmi lesquels l’Espagne, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Arabie saoudite ou encore le Pakistan. Plus de 80 % des ressources renouvelables d’eau seront pompées chaque année dans ces pays. Il s’ensuit que l’eau devrait jouer un rôle beaucoup plus important dans les stratégies nationales visant à atténuer le changement climatique et la perte de biodiversité.
Pour répondre à la demande croissante en eau, une attention accrue est accordée aux alternatives aux sources naturelles d’eau douce. L’une des principales méthodes de production d’eau potable, est le dessalement de l’eau de mer ou de l’eau saumâtre, qui consiste à extraire les sels et les minéraux de l’eau saumâtre ou salée pour obtenir une eau potable pure.
Une conjoncture mondiale en pleine mutation :
À l’échelle mondiale, la capacité installée de dessalement continue de croître, avec une forte concentration dans les régions arides : Moyen-Orient, États-Unis (Californie, Texas), Australie, et la Méditerranée. Le dessalement fournit environ 1 % de l’eau potable mondiale, mais cette part est largement sous-estimée dans les régions à fort stress hydrique où la technique est clé.
Le marché de dessalement mondial (2024) vaut 21,74 milliards USD, en prévision qu’il atteindra 58,38 milliards USD en 2033, le nombre d’usines en 2024 est d’approximativement 22 000 dans 177 pays, produisant environ 95 millions de m³/jour, cela représente presque le double de ce que c’était il y a dix ans et le secteur connaît une croissance de l’ordre de + 6 % à + 12 % de capacités par an, la technologie la plus dominante est la technologie membranaire (notamment l’osmose inverse). La région MENA (la région la plus affectée) ne dispose que de moins de 2 % des ressources en eau renouvelables mondiales alors qu’elle abrite 6 % de la population mondiale, représentent environ 48 % de la production mondiale quotidienne d’eau douce dessalée, avec une capacité contractuelle totale cumulée égale à 49 millions de m3/j en 2017. Un total de 39,3 milliards de dollars est actuellement dépensé dans la région pour des projets d’usines de dessalement, qu’ils soient planifiés ou en cours de réalisation. En tant que riches nations pétrolières dotées d’un bon accès à l’eau de mer, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les deux pays qui investissent le plus dans ce domaine, avec des projets d’une valeur totale respective de 14,6 milliards et 10,3 milliards de dollars. L’Arabie Saoudite, leader incontesté, possède une capacité dépassant 13 millions de mètres cubes par jour, couvrant plus de 80 % de ses besoins en eau. Les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar affichent également une dépendance critique vis-à-vis du dessalement, avec des pourcentages dépassant les 80 % de leur approvisionnement en eau potable. L’Égypte apparaît comme un acteur émergent avec une production annuelle avoisinant 200 millions de mètres cubes (830 000 m³/j).
Au sein de l’Union européenne, 1 901 installations de dessalement en activité, fournir 7,29 millions de m³/jour d’eau douce. Ces installations sont alimentées par l’eau de mer (43 %), les eaux intérieures et/ou saumâtres (47 %) et les eaux usées (10 %). L’Espagne domine le paysage avec environ 2,6 millions de mètres cubes par jour répartis sur près d’un millier d’installations. Des pays comme l’Italie, Chypre, Malte et la Grèce complètent ce tableau avec des capacités plus modestes mais significatives à l’échelle européenne. Malte se particularise par sa dépendance accrue au dessalement pour son approvisionnement en eau potable, bien que son volume absolu reste limité.
De son côté, la Chine possède une capacité de dessalement d’environ 1,57 million de m³/j en 2019, et d’environ 2,86 millions de mètres cubes par jour en 2024, en prévision d’atteindre 3.5 millions de mètres cubes en 2025, avec un total de 158 projets à l’échelle nationale, principalement destinés à un usage industriel dans les régions côtières.
L’Algérie met le cap sur son futur hydrique
La pénurie d’eau pose des défis majeurs pour l’ensemble des pays du monde, où les politiques de l’eau jouent un rôle crucial dans la mobilisation et la gestion des ressources en eau. En Algérie, l’aridité climatique et les problèmes liés au changement climatique ont fait du pays un territoire très vulnérable, où la pénurie d’eau est plus aiguë. Le pays s’approvisionne actuellement en eau à partir de trois sources différentes : les eaux de surface (barrages), les eaux souterraines et le dessalement de l’eau de mer. Grâce à cette diversification des ressources, le pays vise à se protéger des aléas climatiques, notamment des épisodes de sécheresse récurrents. L’indice de stress hydrique de l’Algérie est faible, avec un ratio de disponibilité en eau qui est passé de 1500 m³/hab/an en 1962 à 348 m³/hab/an en 2024, un chiffre bien en deçà du seuil de 1 000 m³/an recommandé par la Banque mondiale pour une sécurité hydrique minimale, ce qui la place dans une situation de pénurie d’eau absolue chronique, selon les projections du World Resources Institute pour 2040, parmi les 20 pays les plus touchés par la pénurie d’eau dans le monde.
L’Algérie a déployé des efforts importants pour remédier à la pénurie d’eau par l’installation d’usines de dessalement et l’extension des capacités de stockage des eaux de surface. Selon l’Algerian Energy Company, le parc national de dessalement d’eau de mer compte 19 stations en exploitation réparties sur l’ensemble du littoral algérien. La capacité de production globale s’élève à 3.7 millions de m3/jour, ce qui représente une contribution de 42 % des besoins nationaux en eau. Le processus, bien que coûteux en énergie, est perçu comme vital pour sécuriser l’approvisionnement en eau dans un contexte de diminution continue des précipitations pouvant atteindre une réduction de 20 % d’ici 2050 dans la région. Les perspectives futures à l’horizon 2030, un programme complémentaire prévoit la réalisation de sept nouvelles stations de dessalement. Une fois opérationnelles, elles porteront la capacité de production nationale à 5,8 millions de m³/jour, couvrant ainsi 60 % des besoins nationaux en eau potable. En effet, et selon document de la présidence de la République, le chef de l’État a ordonné une étude plus approfondie au sujet de la construction de ces nouvelles stations, tout en tenant compte de la pluviométrie dans les wilayas du pays. Dans le même ordre d’idées, le président a donné pour instruction de prioriser les villes à forte densité de population et aux précipitations rares, notamment dans les Hauts-Plateaux. En plus d’une directive à ce que la distribution d’eau dessalée à partir de nouvelles stations soit étendue à moins 250 km des côtes.
Le plus prometteur, une localisation de trois nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer est approuvée durant le conseil des ministres du 19/10/2025 dans les wilayas de Chlef, de Mostaganem et de Tlemcen, avec une capacité de production de 300.000 mètres cubes par jour d’eau potable chacune. Une fois ces projets achevés, l’Algérie s’imposera en tant que leader du dessalement en Afrique et dans la région méditerranéenne.
Vers une symbiose eau-énergie
Cette expansion généralisée répond à un stress hydrique régional croissant, mais soulève d’importants défis environnementaux, particulièrement la gestion énergétique et le traitement des rejets de saumure qui impactent les écosystèmes marins côtiers. La tendance actuelle privilégie l’optimisation des procédés et l’intégration progressive des énergies renouvelables pour atténuer l’empreinte écologique de cette solution hydrique devenue indispensable. Si cette stratégie permet de sécuriser l’alimentation en eau potable, son succès à long terme dépendra de la capacité à intégrer davantage d’énergies renouvelables, à mieux gérer l’impact des saumures par l’exploitation des sels et minéraux issus de cette saumure, et améliorer la durabilité environnementale et à optimiser les technologies pour réduire les coûts et la consommation énergétique et qui pourrait générer des revenus supplémentaires substantiels. Parallèlement, le couplage stratégique avec la filière hydrogène vert pourrait être la clé pour transformer cette nécessité en un atout énergétique et industriel pour l’avenir. Ce jumelage repose sur une complémentarité technique et économique. Le dessalement fournit l’eau pure nécessaire à la production d’hydrogène par électrolyse, tandis que l’hydrogène vert peut servir de vecteur de stockage pour les énergies renouvelables qui alimentent les usines. L’idée maîtresse est d’utiliser des centrales solaires ou éoliennes pour alimenter deux processus : l’électrolyse de l’eau pour produire de l’hydrogène vert, et le dessalement de l’eau de mer pour obtenir l’eau douce nécessaire à cette électrolyse et à la consommation humaine. Par ailleurs, la valorisation de l’énergie excédentaire pour produire de l’hydrogène constitue une option supplémentaire évidente. Cette voie si adoptée consiste à créer des oasis énergétiques littorales (des centres intégrés associant des centrales solaires ou éoliennes, des unités de dessalement et des électrolyseurs).
Dans le même sillage, le privilège des entreprises nationales pour la construction des stations, qui a déjà fait ses preuves en réduisant les délais de réalisation, est un atout. Cette dynamique doit être complétée par la création de partenariats stratégiques avec des pays et des entreprises possédant une avance technologique dans le domaine afin d’échanger des expertises et d’accélérer l’apprentissage. En outre, une gestion rationnelle et un contrôle rigoureux du gaspillage dans la distribution de l’eau potable, que ce soit pour le secteur résidentiel ou industriel, ainsi qu’une révision approfondie et ciblée de la tarification, peut aboutir à une gestion efficace et efficiente du secteur hydraulique dans le pays.
En synthèse, l’adoption de cette approche et la réussite de cette ambition nécessitent la création d’un écosystème industriel dynamique, permettant à l’Algérie de mieux sécuriser son approvisionnement en eau, de produire une énergie propre pour son marché intérieur et pour l’exportation, et de construire une nouvelle filière industrielle créatrice de valeur et d’emplois. Cela en ferait un modèle pour l’Afrique et l’ensemble de la région méditerranéenne, grâce à sa production de plusieurs millions de mètres cubes par jour et à sa stratégie prometteuse d’intégration des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert dans ce domaine.
M.R.C.