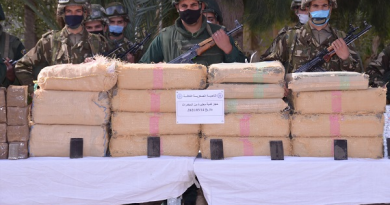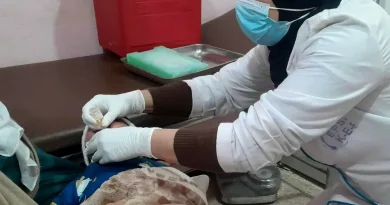Un crime d’État imprescriptible
Le 13 février 1960 marque le début d’une page sombre de l’histoire coloniale française en Algérie avec la première explosion nucléaire dans la région de Reggane, au cœur du Sahara algérien. Cette première bombe, baptisée « Gerboise bleue », d’une puissance estimée entre 60.000 et 70.000 tonnes d’explosifs – soit cinq fois celle d’Hiroshima – allait être suivie de nombreuses autres explosions aux conséquences dévastatrices sur l’environnement et les populations locales. Selon le chercheur universitaire Abdelfettah Belaâroussi, ces essais constituent « un crime et un terrorisme d’État imprescriptible commis par la France coloniale à l’encontre du peuple algérien sans défense. » L’académicien, chercheur en histoire des explosions nucléaires françaises dans la région (université d’Adrar) a indiqué à l’APS que « l’Etat français avait alors choisi la région de Reggane, Sud du pays, comme scène de son crime d’Etat, dans son acception entière, et dont l’arme et la scène du crime sont encore perceptibles ». « Même les victimes sont encore là et les séquelles qu’elles portent encore témoignent de l’abominable crime et de ses effets néfastes sur l’homme et son environnement », a-t-il ajouté. Entre 1960 et 1966, la France a procédé à un total de 57 essais nucléaires sur le territoire algérien : quatre explosions aériennes à Reggane, treize explosions souterraines à In Ecker, trente-cinq explosions supplémentaires à Hammoudia et cinq essais sur le plutonium à In Ecker. Contrairement aux affirmations des autorités françaises de l’époque qui prétendaient effectuer ces essais dans des zones inhabitées, près de 20.000 civils vivaient dans ces régions. Les conséquences de ces explosions continuent aujourd’hui d’affecter gravement la population et l’environnement. Belaâroussi souligne que « ces explosions radioactives dans le Sahara algérien ont été à l’origine de lourdes maladies, dont différents types de cancer, en plus de l’apparition de malformations congénitales chez les nouveaux nés, de maladies ophtalmologiques et d’autres pathologies chroniques causées par la radioactivité, qui n’a rien épargné, y compris le couvert végétal de la région. » La contamination s’est d’ailleurs aggravée au fil du temps en raison des facteurs naturels comme les vents et les tempêtes de sable qui dispersent les particules radioactives, dont l’impact peut perdurer sur des milliers d’années selon certaines études scientifiques. Face à cette situation, l’Algérie a inscrit dans sa législation environnementale nationale la demande de tenir la France pour responsable de l’élimination des résidus de ces explosions nucléaires. Le président Abdelmadjid Tebboune a d’ailleurs affirmé que « les Algériens ont un droit imprescriptible et ils exigent la reconnaissance des massacres commis par le colonisateur » et que « le colonisateur a laissé en Algérie des maladies résultant de ses essais nucléaires dont souffrent encore aujourd’hui nos compatriotes dans le Sud. »
Paris fait la sourde oreille
Pour le président de la Fondation du 8-Mai 1945, Abdelhamid Salakdji, le contexte historique de ces essais s’inscrit dans la volonté de la France de « se doter de l’arme nucléaire pour se hisser au diapason des puissances de l’époque, notamment les États-Unis d’Amérique, l’Union soviétique et le Royaume-Uni. » Il souligne que la France « porta naturellement son choix sur le sol algérien qu’elle occupait, spoliait sans vergogne et administrait, en faisant fi des conséquences que cela pouvait avoir sur les populations autochtones, dépossédées de leurs terres. » L’Algérie exige aujourd’hui que la France assume ses responsabilités en fournissant les cartes des sites d’enfouissement des déchets nucléaires, en procédant à la décontamination des zones affectées et en restituant les archives techniques et médicales liées à ces essais.
En 2021, l’État a créé l’Agence nationale de réhabilitation des anciens sites d’essais et d’explosions nucléaires pour faire face aux risques de pollution radioactive. Le président Tebboune a souligné que le dossier du nettoyage des sites des explosions nucléaires est « nécessaire » et constitue « un devoir humanitaire, moral, politique et militaire. » Malgré les recommandations du rapport de l’historien Benjamin Stora remis au président Emmanuel Macron en 2021, la France continue de faire la sourde oreille à ces revendications qui constituent pourtant un enjeu central dans les relations algéro-françaises. Cette situation illustre la persistance d’un contentieux historique majeur entre les deux pays, dont la résolution apparaît comme une condition préalable à l’établissement de relations bilatérales apaisées. Comme le conclut Abdelhamid Salakdji : « Nous avons payé un tribut extrêmement lourd pour le recouvrement de notre souveraineté et, aujourd’hui, notre Fondation refuse de payer le tribut de l’oubli. »
Chokri Hafed