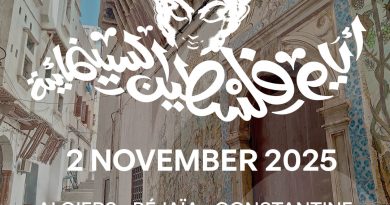Mohamed Sahnouni : « L’Algérie doit former ses futurs archéologues »
À l’occasion de la Journée nationale de l’étudiant et dans le cadre du mois du patrimoine, le Musée du Bardo a accueilli samedi une rencontre scientifique qui a réuni étudiants et jeunes bénévoles autour d’un thème central : le rôle du patrimoine dans la construction de l’identité algérienne.
L’événement, organisé en prélude à la cérémonie de distinction du savant algérien 2024, a donné la parole à Mohamed Sahnouni, expert reconnu en archéologie et lauréat de la médaille « Algerian Scholar Award ». Pour ce chercheur de renom, l’urgence est claire : « L’Algérie doit se concentrer sur la formation supérieure pour créer une élite capable de mener un travail minutieux dans le domaine archéologique. » Cette exigence s’inscrit dans un contexte où les découvertes se multiplient sur le territoire national, révélant des trésors d’une valeur inestimable pour l’histoire de l’humanité. Les sites d’Aïn Lahnech et d’Aïn Boucherit, par exemple, comptent parmi les plus anciens d’Afrique et témoignent des premiers comportements humains et de l’adaptation de notre espèce en Afrique du Nord.
« Le patrimoine matériel et immatériel de l’Algérie dans ses différentes composantes, sites et monuments archéologiques, véhicule des significations qui vont au-delà des frontières du pays, constituant ainsi une source de fierté pour les jeunes algériens qui peuvent contribuer à l’immunisation de l’identité nationale », a souligné Mohamed Sahnouni. Cette vision dépasse largement le cadre scientifique pour s’ancrer dans une démarche identitaire profonde, et renforce la conscience collective d’appartenir à une civilisation millénaire.
L’expert puise ses arguments dans l’extraordinaire richesse archéologique algérienne. Des peintures rupestres du Tassili N’Ajjer aux mystères de l’Ahaggar, en passant par les vestiges qui jalonnent tout le territoire, l’Algérie révèle progressivement son statut de « berceau des civilisations depuis le début de l’humanité ». Ces découvertes successives ne cessent de repousser les limites de notre compréhension des origines humaines et du développement des premières sociétés.
Face à ce potentiel exceptionnel, Sahnouni plaide pour une approche pédagogique innovante : « Il faut associer les étudiants universitaires et les lycéens aux sorties de prospection et d’exploration pour approfondir la conscience quant aux enjeux auxquels l’Algérie fait face pour protéger son histoire et défendre son identité et sa culture. » Cette proposition s’accompagne d’un appel à « la généralisation des programmes archéologiques dans tous les niveaux de scolarité », témoignant d’une volonté de démocratiser l’accès au patrimoine. Cette rencontre s’inscrit dans la mission de la Fondation « Algerian Scholar Award », institution culturelle bénévole qui met à l’honneur les savants et chercheurs algériens ayant distingué leur pays par leurs travaux. En célébrant ces figures de l’excellence scientifique, la fondation participe à la construction d’un modèle inspirant pour les jeunes générations, leur montrant que la recherche et la découverte constituent des voies privilégiées pour servir leur nation.
L’enjeu dépasse la simple conservation du passé. Il s’agit de former les gardiens de demain, ces archéologues qui sauront « révéler de nouvelles découvertes et mettre en exergue les sites archéologiques et historiques dans le cadre d’une vision nationale ». Dans un monde en mutation rapide, où les identités se cherchent et se redéfinissent, l’Algérie dispose avec son patrimoine d’un atout majeur pour ancrer ses citoyens dans une histoire riche et une culture authentique.
Mohand Seghir