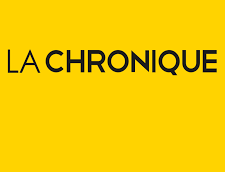Pays pauvres, marché carbone, et subventions fossiles : L’équation impossible de la justice climatique

Par Mohamed Rachid Cheriti
Ingénieur spécialisé dans le domaine énergétique et le développement durable.
Un double piège se referme sur les pays pauvres dépendants des énergies fossiles, dont les hydrocarbures représentent plus de 80 % des recettes publiques : la transition énergétique est un dilemme insoluble. D’un côté, ils subissent de plein fouet la baisse programmée de la demande mondiale en fossiles, risquant un effondrement économique. De l’autre, ils manquent cruellement des capitaux et des technologies nécessaires pour investir massivement dans les énergies renouvelables, malgré un potentiel solaire et éolien souvent sous-exploité.
Dans un monde où les discours sur l’urgence climatique dominent les tribunes internationales et où les engagements en faveur de la neutralité carbone se multiplient, un phénomène économique massif, et pourtant méconnu du grand public, continue de saper systématiquement les efforts de décarbonation. Ce sont les subventions aux énergies fossiles. Ces subventions représentent aujourd’hui l’un des plus grands paradoxes de notre époque en matière de politique énergétique et environnementale. Elles constituent l’un des principaux obstacles à la transition écologique.
À un moment critique de notre histoire, où la fenêtre d’action collective pour lutter contre le changement climatique se rétrécit, les entreprises du secteur des combustibles fossiles continuent de profiter de l’exploitation de la Terre, alors même que celle-ci exige une sortie progressive de ces énergies polluantes. Cette approche sape le modèle principal responsable d’élimination des émissions des gaz à effet de serre moteur de la dégradation écologique, car il est évident que l’écoblanchiment de la crise climatique dépourvu d’actions concrètes ne fait que créer l’illusion d’une responsabilité environnementale sans s’attaquer véritablement aux réalités de l’effondrement climatique. Par ailleurs, les investissements dans les énergies propres restent insuffisants, et les mesures de réduction des émissions progressent trop lentement pour inverser la tendance. Les subventions aux combustibles fossiles ont un effet dissuasif sur les investissements dans la transition énergétique, car elles rendent la concurrence des énergies renouvelables plus difficile, surtout lorsqu’elles ne bénéficient pas du même niveau de soutien. Bien que leur suppression progressive soit complexe, en particulier pour les pays en développement, elle contribuerait à encourager les investissements dans les énergies renouvelables. En réalité, la malédiction concerne avec plus d’acuité les pays développés, mais dépasse le cadre des nations les plus démunies, dont les revenus pétroliers constituent l’unique source de financement des budgets publics.
Les subventions aux fossiles et les investissements bas-carbone
En 2023, selon le Fonds monétaire international (FMI), les gouvernements du monde entier ont dépensé 7 000 milliards de dollars pour soutenir le pétrole, le gaz et le charbon, soit l’équivalent de 7,1% du PIB mondial, et l’équivalent du PIB annuel de la France et de l’Allemagne réunies, 13 fois le budget annuel de la santé publique mondiale et 7 fois les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables. Ce montant pharaonique, difficilement concevable pour l’esprit humain, dépasse de très loin les budgets alloués à la santé publique mondiale ou à l’éducation dans les pays en développement. La Chine arrive en tête avec 2 200 milliards de dollars annuels, principalement pour soutenir son industrie charbonnière. Les États-Unis (700 milliards) et l’UE (300 milliards) complètent ce trio controversé. Par contre, le rapport World Energy Investment 2025 de l’AIE montre que les flux de capitaux vers le secteur de l’énergie devraient augmenter en 2025 pour atteindre 3 300 milliards de dollars, soit une hausse de 2 % en termes réels par rapport à 2024. Environ 2 200 milliards de dollars sont consacrés aux énergies renouvelables, au nucléaire, aux réseaux, au stockage, aux carburants à faibles émissions, à l’efficacité énergétique et à l’électrification, soit deux fois plus que les 1 100 milliards de dollars consacrés au pétrole, au gaz naturel et au charbon.
Selon le même rapport, les investissements des compagnies pétrolières et gazières dans les technologies à faibles émissions devraient encore diminuer de 10 % en 2025. Environ 60 % des investissements de l’industrie pétrolière et gazière dans ces technologies ces dernières années proviennent de quatre entreprises : BP, Equinor, Shell et TotalEnergies (qui ont chacune consacré environ 15 à 25 % de leur budget total aux énergies à faibles émissions). À l’exception de TotalEnergies, ces entreprises ont annoncé d’importantes révisions de leurs objectifs antérieurs en matière de dépenses liées aux énergies à faibles émissions. Par exemple, BP a réduit son objectif de part des technologies à faibles émissions dans son budget d’investissement total en 2030 de 50 % à 10-15 %, Shell a réduit son objectif pour 2030 de 15-20 % à 10 %, et Equinor a réduit sa part prévue de dépenses en technologies à faibles émissions pour 2025 de 30 % à 13 %, et a abandonné son objectif précédent d’investissement de 50 % d’ici 2030. De nombreuses analyses indépendantes ont confirmé qu’aucune grande entreprise pétrolière et gazière n’a adopté de plan de transition pour abandonner son modèle économique axé sur l’expansion pétrolière et gazière. Au cours des deux dernières années, plusieurs entreprises ont abandonné leurs engagements climatiques, redoublant d’efforts pour développer leurs activités pétrolières et gazières face à la hausse des rendements du secteur. Aucune grande entreprise pétrolière et gazière ne s’engage à mettre fin à toute nouvelle expansion au-delà des gisements existants.
Selon l’IRENA, le secteur mondial des énergies renouvelables a franchi une étape historique en 2024, avec des ajouts de capacité atteignant 582 gigawatts (GW). Il s’agit d’une augmentation de 19,8 % par rapport aux ajouts de capacité réalisés en 2023 et de la plus forte expansion annuelle jamais enregistrée. Le solaire photovoltaïque (PV) a dominé cette augmentation de capacité, contribuant à hauteur de 452,1 GW, soit 77,8 % du total. Il est suivi par l’éolien, avec 114,3 GW (19,6 %), puis par l’hydraulique, avec 9,3 GW (1,6 %). Avec de faibles quantités de bioénergie, de géothermie et d’énergie marine, ces ajouts ont porté la capacité mondiale d’énergie renouvelable à 4 443 GW.
Le paradoxe est que l’OPEP stipule que le pétrole restera indispensable jusqu’en 2050, elle prévoit une demande pétrolière à 110 millions b/j en 2045 (+15% vs 2024), tandis que l’AIE énonce que tout nouveau projet fossile est incompatible avec l’objectif de +1.5°C, elle anticipe un pic dès 2028 (scénario NZE).
Un marché carbone inéquitable
Malgré l’accord mondial visant à limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 °C prévu par l’accord de Paris, l’article 6 de cet accord permet la coopération internationale pour lutter contre le changement climatique et débloquer des soutiens financiers pour les pays en développement. Masque davantage la perpétuation des projets d’énergies fossiles qui détruisent les peuples autochtones, les communautés et les territoires sous un vernis d’économie verte.
Le marché carbone est un système d’échange de droits d’émissions de CO₂, visant à réduire les émissions polluantes en fixant un prix sur la pollution. Les marchés du carbone sont des boucles de rétroaction financière permettant aux pollueurs de justifier davantage leur profanation de notre environnement. Les pollueurs du Nord achètent des compensations de pollution plutôt que de réduire directement leurs émissions. Ces marchés du carbone ne sont qu’un écran de fumée pour maintenir le statu quo, perpétuant les cycles d’extraction et de violence que nous devons rejeter résolument. Si les marchés du carbone permettent bien de fixer une limite maximale aux émissions, encore faut-il que cet objectif soit ambitieux. Les pays riches utilisent souvent les crédits carbone pour éviter de réduire leurs propres émissions, alors que les pays pauvres subissent déjà les pires impacts du changement climatique. C’est une inégalité face à l’adaptation climatique.
La méthode d’allocation de quotas, plutôt favorable aux entreprises, n’est pas étrangère à ce phénomène. Lors des deux premières phases du marché (2005-2012), les quotas distribués aux industriels étaient ainsi fondés principalement sur leurs émissions passées et non sur des objectifs à atteindre. Parfois même, certains groupes recevaient plus de quotas que ce dont ils avaient besoin. Dans une telle situation, le marché ne rémunère pas les bonnes pratiques mais l’absence d’action. Se voir attribuer plus de quotas que ses émissions est un problème majeur puisque le prix du carbone est mécaniquement tiré à la baisse, l’offre étant plus grande que la demande.
Le marché carbone pourrait être une opportunité pour les pays pauvres s’il est mieux encadré. Mais sans régulation forte, il risque de reproduire des déséquilibres économiques et de servir d’échappatoire aux pays riches. La clé réside dans une gouvernance plus équitable, où les compensations ne remplacent pas les réductions d’émissions à la source.
Un système énergétique en crise
Notre époque, marquée par l’accélération du réchauffement planétaire, illustrée par les tempêtes et la fonte des glaces, les sécheresses et la faim, les troubles et les migrations, renforce de plus en plus le sentiment d’urgence de mettre rapidement fin à l’ère des énergies fossiles. Car derrière les chiffres astronomiques se cache une réalité bien concrète : chaque dollar dépensé aujourd’hui à soutenir les énergies fossiles est un dollar qui manquera demain pour financer la transition énergétique, aggravant d’autant la crise climatique dont nous commençons à peine à mesurer l’ampleur des conséquences. Chaque année de maintien de ces substitutions nous éloigne un peu plus des objectifs climatiques et enfonce le monde dans une dépendance mortifère aux énergies du passé. Pourtant, cette situation n’est en rien une fatalité. Plusieurs pays ont déjà démontré qu’une sortie progressive et bien planifiée des subventions fossiles était possible, à condition d’y mettre la volonté politique nécessaire et de mettre en place des mécanismes d’accompagnement efficaces. Un consensus croissant considère désormais la transition vers les systèmes d’énergies renouvelables, souvent comprise comme un processus de substitution des combustibles, comme une stratégie clé pour faire face à la crise climatique.
La balle est désormais dans le camp des décideurs politiques, des institutions financières internationales et des citoyens, en particulier ceux des pays développés, historiquement les plus pollueurs. En effet, les nations industrialisées, responsables de plus de 60 % des émissions cumulées de CO₂ depuis 1850, ne peuvent se contenter d’une logique de compensation a posteriori, où polluer aujourd’hui signifie indemniser demain les dégâts causés aux pays pauvres. Une telle approche non seulement ne constitue pas une solution durable, mais aggrave le fardeau économique, écologique et social que devront supporter les générations futures.
Les coûts de l’inaction sont déjà exorbitants. Selon la Banque mondiale, les pertes économiques liées aux catastrophes climatiques pourraient plonger plus de 130 millions de personnes dans l’extrême pauvreté d’ici 2030, principalement dans les régions les moins responsables du réchauffement. Pourtant, les mécanismes financiers actuels, comme les fonds climatiques internationaux, restent sous-dotés et inefficaces, laissant les pays vulnérables sans moyens suffisants pour s’adapter. Le marché carbone, souvent présenté comme une solution, aggrave paradoxalement les inégalités. Les mécanismes de compensation carbone, comme les crédits issus de projets de réduction d’émissions dans les pays du Sud, profitent davantage aux multinationales et aux États riches qu’aux communautés locales. Par exemple, en Afrique (dont les émissions représentent moins de 4% des émissions mondial en CO2), des projets de reforestation ou d’énergies renouvelables financés via ces crédits peuvent conduire à l’accaparement des terres ou à une dépendance technologique, sans transfert réel de compétences ni de revenus durables. Pire, certains pays pauvres se retrouvent contraints de vendre à bas prix leur droit à polluer (via des quotas d’émissions) pour des liquidités immédiates, tandis que les entreprises des pays riches continuent d’émettre en toute impunité.
Pire encore, un double piège se referme sur les pays pauvres dépendants des énergies fossiles, dont les hydrocarbures représentent plus de 80 % des recettes publiques : la transition énergétique est un dilemme insoluble. D’un côté, ils subissent de plein fouet la baisse programmée de la demande mondiale en fossiles, risquant un effondrement économique. De l’autre, ils manquent cruellement des capitaux et des technologies nécessaires pour investir massivement dans les énergies renouvelables, malgré un potentiel solaire et éolien souvent sous-exploité. Sans un soutien financier et technologique massif des pays riches, ces nations se retrouvent prises en étau, incapables de renoncer aux fossiles à court terme, elles sont pourtant les premières victimes des dérèglements climatiques qu’elles contribuent malgré elles à aggraver. L’équation est tragique : aujourd’hui, leur survie économique dépend des énergies du passé, mais leur avenir est hypothéqué par l’absence de transition juste.
In fine, le temps des demi-mesures et des doubles mesures est révolu, chaque année de retard accroît le risque d’un scénario où les inégalités climatiques deviendront irréversibles, avec des pays pauvres à la fois s’appauvrissant davantage par les effets carbones et des mécanismes de marché carbone déséquilibrés, et les pays riches s’enrichissant encore en profitant de cette situation et grâce à leurs prévisions anticipées envers les scénarios possibles.